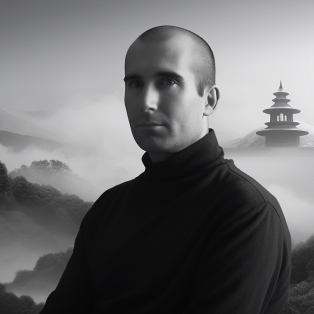Lobsang, Namgar escorté d’un guide et d’un milicien Hazara entreprirent de gravir la vingtaine de mètres les menant à l'entrée de la grotte, nichée en hauteur. Cette ouverture, taillée à même la falaise, surplombait vertigineusement le vide.
Les grains fins s'envolaient par moments sous la caresse du vent
La falaise, à quelques mètres des bouddhas géants de Bamiyan, était percée d’une trentaine d’ouverture, l’ensemble s'étendait sur plusieurs étages et offrait un accès à un réseau sinueux de cavités.
L'une des plus notables était la grotte K3, un espace oblong avec une niche principale qui abritait autrefois une importante figure de culte, qui était maintenant disparue. Cette grotte présentait des traces de peintures murales fascinantes, représentant une frise de Bouddha en méditation, qui ne ressemblaient à aucune autre représentation de Bouddha trouvée dans la région.
D'autres niches dans la grotte abritaient autrefois des peintures et des sculptures, mais beaucoup avaient été endommagées ou recouvertes de suie au fil des ans. Cependant, la structure elle-même, avec ses voûtes, ses escaliers et ses entrées variées, témoignait de l'ingéniosité et de la dévotion de ceux qui l'avaient construite.
Entre la niche obscure et l'angle sud-ouest de la grotte mystérieuse, Lobsang et Namgar découvrirent, non sans une pointe d'émotion, ce qui semblait être une représentation de Parinirvâna, gravement endommagée par le temps. Le Parinirvâna était un terme sanskrit désignant une totale extinction après l’atteinte du nirvana, excluant définitivement toute réincarnation.
Ce tableau rupestre, probablement l'une des plus sublimes œuvres de Bâmiyân voir de tout le Gandhara, était dominé par la silhouette du Bouddha étendu, enveloppé de sérénité même dans l'éternité.
Dans la pénombre de la grotte, Lobsang et Namgar découvraient émerveillés une fresque ancienne dépeignant le Parinirvâna du Buddha, terme sanskrit pour une totale extinction après l’atteinte du nirvana. Cette scène, entourée de figures endeuillées, était bordée par des arbres majestueux, sous les disques du soleil et de la lune.
Le Buddha, dont le visage et le torse s'étaient partiellement effacés avec le temps, reposait paisiblement, sa main gauche sur la jambe. Des traces d'ocre-violet sur son vêtement monastique révélaient les couleurs d'origine. Au-dessus, une mandorle enflammée apportait une touche divine.
Autour, des objets dispersés évoquaient des récits de voyageurs chinois. Les personnages, bien que détériorés, se discernaient : moines, brahmanes et fidèles, tous plongés dans leur deuil. Des divinités veillaient, notamment Sûrya, le dieu solaire.
À gauche du lit, deux figures, l'une debout, l'autre agenouillée, évoquaient des génies. Un hamsa blanc planait au-dessus. À droite, la silhouette de Subhadra, dernier converti, se détachait avec ses flammes d'épaules.
Près de lui, Vajrapâra, marqué par le chagrin, émergeait, vêtu d'une simple dhôti rouge. Un vajra entouré de flammes et des motifs de losanges complétaient la scène, rappelant les arts d'autres régions asiatiques.
Pour Lobsang et Namgar, cette fresque était un trésor d'une époque révolue, un témoignage artistique unique, mélangeant influences locales et étrangères, et gardant encore ses secrets.